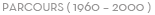Les Géants
Lorsqu’on parcourt dans sa totalité la série des Géants que José Giger a inaugurée en 1994, c’est la prégnance du format vertical allongé que l’on retient d’abord, puis la partition géométrique et orthogonale de la surface en plans de différentes couleurs. Ainsi le parti semble être celui de l’abstraction.
Mais à y regarder de plus près, le doute s’insinue : il y a, dans chacune des compositions, un haut et un bas, les formes s’y distribuent le plus souvent symétriquement de part et d’autre d’un axe vertical, et par le jeu des proximités ou des contrastes de tons et de valeurs, les plans s’échelonnent en profondeur, les pleins et les vides alternent, la surface se creuse, elle s’ouvre, elle fait figure, elle s’abîme, elle devient image.
C’est évidemment de l’image du corps dont il s’agit, de sa présence frontale et dressée, de ce vertigineux face à face où tentent de se conjuguer l’extériorité de l’objet et l’intériorité du sujet. Mais c’est aussi l’image du corps dans sa relation ambiguë à l’espace, qui tantôt vient s’y cogner, tantôt l’étreint, puis le pénètre jusqu’à s’y perdre en le traversant de part en part.
La filiation des Tikis de la fin des années 80 aux Géants devient évidente. Giger rendait compte alors de sa rencontre avec les fameuses sculptures des Iles Marquises, de cette irruption mystérieuse et magique d’une présence ayant forme humaine et animale au milieu de la nature luxuriante et sauvage.
Dès lors, la sculpture semble être au centre de ses préocupations, comme objet figuré certes, comme expérience plastique aussi, mais surtout, comme métaphore de la peinture.
On se souvient peut-être de ses toiles des années 80, de leur caractère atmosphérique et spatial, de leur substance chromatique fluide, opalescente et gazeuse, proche du monochrome, évoquant les éléments naturels comme l’eau, l’air et la lumière, de leurs titres suggestifs, ouverture, faille, gouffre etc..
Aujourd’hui, en dressant des images construites, stables, dont la densité matérielle est acquise, Giger chercher à offrir une résistance au vertige de la profondeur pure, réalisant sans doute que c’est dans l’affirmation et la présence de sa surface que la peinture révèle le mieux aujourd’hui son intériorité.
Edmond Charrière, mars 1997